PLAN SEQUENCE - LILLE - PEUR EN NOIR ET BLANC

Du 08 au 21 octobre 2008
Les réussites de Frankenstein, La Fiancée de
Frankenstein et L’Homme invisible s’inscrivent dans un véritable âge
d’or du cinéma fantastique au début des années 30. Comme beaucoup d’autres, ils
ont été produits par la firme Universal qui lança cette vogue reprise par les
autres grands studios hollywoodiens. Ils imposent de formidables talents comme
le réalisateur James Whale, auteur des trois films, ou l’acteur Boris Karloff
qui personnifie à jamais la figure du monstre de Frankenstein. La réédition en
copie neuve par Carlotta (qui fête ses 10 ans) de ces trois films constitue un
véritable événement. A cette occasion, nous leur avons associé d’autres grands
classiques du fantastique américain qui, eux aussi, privilégient l’atmosphère,
le mystère et l’angoisse avec comme fil conducteur, le fait qu’ils aient été
tournés en noir et blanc.
http://www.plan-sequence.asso.fr/cycle_detail.php?id_cycle=80
Films :
• Angoisse
•
Frankenstein
•
L'Homme
invisible
• L'Ombre d'un
doute
• La
Féline
• La Fiancée de
Frankenstein
• La Maison du
diable
• La Nuit du
chasseur
• Psychose
Lille
Majestic
54, rue de Béthune (59000)
Soirée débat du 24 octobre
Le vendredi 24 octobre, l'Alhambra accueillera l'Association ARDEVA. (Association pour la défense des victimes de l'amiante)
Après la projection du film de Brigitte Chevet "Mourir d'amiante" Pierre PLUTA et Aimé CARBONNIER nous présenteront l'ARDEVA 59/62
Créé en 1996, les buts de l’ANDEVA sont les suivants :
Promouvoir l’entraide et la
solidarité entre les victimes de l’amiante, les regrouper pour défendre leurs
intérêts,
Aider à la reconnaissance de
toutes les maladies liées à l’amiante (déclaration, recherche des expositions,
aide juridique)
Obtenir une indemnisation
équitable pour toutes les victimes de l’amiante (travailleurs salariés,
travailleurs non salariés, victimes environnementales) ainsi que pour les
ayants droit des victimes décédées
Aider les personnes qui engagent
des actions en justice pour obtenir réparation de leurs préjudices et
sanctionner les responsables de la catastrophe.
Améliorer les conditions d’accès
à la Cessation
Anticipée d’Activité,
Obtenir un suivi médical de
qualité pendant et après l’activité professionnelle,
Informer toutes les personnes
susceptibles d’être exposées au risque amiante, les aider à se protéger et à se
défendre, améliorer la prévention pour éviter de nouvelles victimes,
Agir collectivement et
représenter les victimes auprès des caisses primaires, du Fonds d’indemnisation
des Victimes de l’Amiante, des institutions médicales et des pouvoirs publics,
Imposer des réformes profondes en matière d’indemnisation des maladies, de médecine du travail et de prévention des risques professionnels.
Cantate à CANTET sur Critikat
Mercredi 24 septembre 2008, Entre les Murs de Laurent Cantet est (enfin) en haut de l’affiche. La Palme d’Or 2008 a fait couler beaucoup d’encre, de même couleur, unanime. A l’instar des raisons avancées d’une telle récompense par la président du Jury (Mr. Sean Penn), (« Un film, vraiment, vraiment étonnant ! »), on s’accorde à couronner le film de vertueux prédicats. Entre les murs est social, sensible, engagé, fort, politique… Retour sur la courte filmographie d’un des cinéastes français les plus prometteurs...
Déjà, jadis, on affiliait volontiers Laurent Cantet à un cinéma social : dès son court-métrage Jeux de Plage en 1995, en passant par son segment de la collection « 2000 vu par … » appelé Les Sanguinaires, mais aussi avec Vers le Sud en 2005, on sentait l’application à aborder les tourments psychologiques de ses personnages en les confrontant à l’échelle de la société. Et doucement, on glissait parfois du terme « fiction sociale » à celui, plus immodéré de « cinéma engagé ». La faute sans doute au court- métrage Tous à la manif ! (1993), et à ses deux fictions sur le monde du travail, Ressources Humaines (1999) et L’Emploi du temps (2001)… Des abus de langage ? Peut-être. Evitons d’emprunter des raccourcis : Laurent Cantet n’est pas un cinéaste militant (le choix de ses titres –Ressources Humaines, L’Emploi du temps – renvoie à une neutralité, qui diffère par exemple du titre plus partisan d’une autre fiction sociale, celle de Lucas Belvaux, La Raison du plus faible).
Réduire son œuvre à un statut politique c’est douter de son art. Cantet ne fait pas de la politique mais bel et bien du cinéma, à sa juste définition d’ailleurs, en tant que miroir d’un monde contemporain. Il trace dans son reflet les lignes de fuite aspirant à la transcendance du spectateur. Car si Laurent Cantet réalise des fictions engagées c’est à entendre de cette façon : son cinéma refuse le désengagement, la négation d’un monde réel. Il s’adonne exclusivement à la fiction tout en empruntant au documentaire pour renouveler la narration. Il use d’une base scénaristique fictionnelle forte qui érige ses personnages en de véritables héros, mettant pendant le tournage dramaturgie à l’épreuve du réel (Cantet cherche à valider ses idées de scénariste pendant le tournage, notamment en modifiant les dialogues). La fiction reste ainsi le document d’une époque, elle flirte avec le réel, et mêle par exemple des comédiens professionnels et amateurs. Panacher comme gage d’équilibre, équilibrer pour exprimer un regard sur le monde, voilà les fondements qui servent la cohérence de l’œuvre de Cantet. Une œuvre qui soutire son originalité non pas par son renouvellement des formes, mais par l’invention d’une façon de raconter. Cantet sait distiller le réel tel un parfumeur qui extrait l’essence d’une fleur. Il nous fait (res)sentir l’air du temps. Regardons de plus près la force de ce pouvoir fictionnel.
L’humain au travail : de la thématique à son incarnation
Aux prémisses des fictions de Laurent Cantet : le quotidien. Egalement racine caractéristique des films du néo-réalisme italien, le travail devient le sujet récurrent de Ressources Humaines et L’Emploi du temps. Non seulement le travail fait partie intégrante du quotidien, mais c’est aussi l’activité la plus réelle de l’homme, pour ne pas dire la plus « humaine ». Cantet relève donc l’audacieux défi de proposer un cinéma qui n’offre pas un divertissement hors de la vie, mais une peinture du réel. Mais Cantet refuse la qualification de cinéaste du travail. C’est une notion qu’il aborde car il parle avant tout de l’humain ; en cela le plan d’ouverture des Sanguinaires (un insert sur une main qui caresse un clavier d’ordinateur) peut être lu comme la métaphore du monde du travail contemporain. C’est dans ce rapport homme/travail que le cinéaste aborde l’image que l’humanité a d’elle-même : une image de domination, et donc de servitude. Cela se traduit par une caractérisation des personnages concentrée sur leur métier. Dès la première scène de Ressources Humaines, la profession des personnages nous est livrée au même titre que les liens familiaux. De la même façon, Entre les murs est introduit par la réunion de pré-rentrée des professeurs du collège. Cette manière de mettre en avant la place de ses protagonistes dans la société n’est pas sans rappeler Toni ou Boudu sauvé des eaux, deux films de Jean Renoir qui nouent leur dramaturgie à partir de la catégorie sociale des héros.
C’est dans la confrontation de ses héros avec la vie que Cantet porte un regard critique sur la société du travail, qui ne tient plus que sur l’espérance, et qui a perdu la raison. Il constate le non-sens du travail dans une époque contemporaine elle aussi non sensée. Le monde a ses raisons sociales que la raison ne connaît pas : en témoignent les interrogations de François (François Bégaudeau), le professeur d’Entre les murs, sur le bien-fondé du règlement du collège. Egalement, lorsqu’il porte à l’écran le fait divers à l’origine de L’Emploi du Temps, Laurent Cantet et son scénariste Robin Campillo font le choix de transformer l’issue du drame. Vincent (Aurélien Recoing) ne passe jamais à l’acte dans la fiction, et le film s’achève non pas sur le meurtre de sa famille mais sur l’annonce d’un nouvel emploi. C’est justement dans ce contrepoint apporté par cette libre adaptation que l’on découvre un discours « politique » (même si non revendiqué) au film. Vincent poursuit sa quête du bonheur dans le renoncement du travail. Autrement dit, il exprime que le bonheur ne réside pas dans la normalité. Dans une société gouvernée par le capital, le positionnement radical de Vincent apparaît comme subversif. De la même façon, dans Ressources Humaines, Laurent Cantet n’omet pas de montrer les ouvriers comme les créateurs de richesses, mais aussi comme les plus pauvres.
Toute la finesse du cinéma de Cantet est de ne jamais mettre la charrue avant les bœufs : on ne fait pas un film d’idées, c’est tout simplement les héros qui véhiculent par leur action des perspectives d’interprétations philosophiques, sociologiques ou encore politiques. En effet, si on sent un discours critique et contestataire à l’égard de la société c’est parce que Cantet met en place dans sa narration une solide caractérisation psychologique de ses personnages qui entre automatiquement en conflit avec les rouages et les enjeux du monde moderne. La méthode est la suivante : une histoire simple, qui vient mettre en relief une actualité de société. L’atout de la fiction pour parler du réel c’est ici, grâce à une dramaturgie basique, de pouvoir laisser le temps aux situations de se développer. C’est le même sentiment de proximité et d’identification qui jaillit chez le lecteur de la trilogie de Jules Vallès (L’Enfant, Le Bachelier, L’Insurgé) qui à la première personne, dévoile son intimité sur fond d’événements politiques majeurs de la France du 19ème siècle. A l’instar aussi de la dernière scène de Ressources Humaines où l’enjeu est la situation entre le père et le fils dans un environnement d’appel à la grève. Dans les deux cas, le fait collectif devient le révélateur d’un conflit personnel et intime. Pour ce faire, la fiction se doit d’être documentée (notons dans Tous à la manif ! la place accordée aux revendications des lycéens) et « documentaire ». On reconnait que dans Entre les murs, les références au documentaire sont davantage présentes. Et cela apparaît notamment dans le traitement de la dimension psychologique des personnages, similaire à l’écriture documentaire de Frédérick Wiseman avec entre autres Juvenile Court (1974). C’est-à-dire que l’intimité des personnages de Entre les murs est traitée comme une intimité de personnes. Avec la même distance que le documentariste, Cantet et Wiseman réussissent à provoquer des accointances avec les protagonistes.
Une place : père et fils
Cantet ajoute un écho universel à ses histoires, tout en représentant chaque environnement comme des micro-sociétés (collège, entreprise), qui s’emboîtent les unes aux autres, telles des poupées gigognes. Ainsi, la famille est la plus petite d’entre elles, et elle apparaît sous les figures du père et du fils. C’est le cas dans Tous à la manif !, Jeux de plages et Ressources Humaines. Ce rapport souvent conflictuel donne lieu à des scènes magistrales : la course poursuite sur les rochers des calanques dans Jeux de plage, la scène du plateau en équilibre ou encore celle où le fils déchire la nappe du café de son père pour en faire une banderole, dans Tous à la manif !. Voilà un autre point fort de la narration de Cantet : il introduit du symbolique de façon inventive et subtile. La source du conflit qui anime souvent la relation père/fils des films de Cantet est la honte. Ce schéma fort était déjà présent dans le chef-d’œuvre de De Sica Le Voleur de bicyclette (1949), film dans lequel le père doit supporter le regard réprobateur de son fils et affronter sa propre honte pour survivre. Dans Ressources Humaines, le sentiment de honte opère des va-et-vient entre le père et le fils, il est tabou et est finalement plus traductible par « la honte d’avoir honte ». Le rapport aux pères, symbole des racines, questionne l’origine sociale des fils. Antony Cordier dans son documentaire Beau comme un camion (1999), met le doigt sur ce qui ne se dit pas entre Franck (Jalil Lespert) et son père dans Ressources Humaines : le complexe du milieu ouvrier, la servitude au travail.
Cinéaste humaniste au même titre que Jean Renoir, il n’est pas question pour lui de proposer une vision duale, manichéenne de l’Homme. Montrer l’humain c’est aussi parler de ses nuances, exposer les incohérences de chacun : dans Tous à la manif !, sans jugement, Cantet présente une bande de lycéens remplis d’idéaux politiques mais oubliant parfois le geste altruiste au quotidien. Constater avec intuition, c’est l’habilité de Cantet, et s’il crée des personnages qui cherchent leur place, lui a trouvé la sienne.
Le chez-soi : un ici et un ailleurs
Les lieux, les décors, tiennent eux aussi une place de choix dans cette filmographie. Ils peuvent être la traduction par l’image d’un égarement intérieur des personnages (Vers le Sud, L’Emploi du Temps) ou l’endroit du rassemblement, de la réunion (le café dans Tous à la manif !, ou encore la salle de classe dans Entre les murs) et dans ce cas l’expression de la recherche d’un chez-soi.
Formellement, c’est dans Entre les murs et L’Emploi du temps que la spatialité est travaillée avec des partis pris formels radicaux. Dans Entre les murs, véritable huis-clos, lorsqu’on exclut un élève du collège, il l’est aussi du film. Dans L’Emploi du temps, l’omniprésence des vitres fait de Vincent un spectateur, car elles le séparent de son environnement. Par ailleurs, le montage fonctionne avec une alternance de séquences (les moments en famille/ les échappées solitaires) et devient une sorte de mise en image d’un emploi du temps en proposant l’alternance de ces deux vies parallèles, similaire à un enchaînement de semaines.
Laurent Cantet n’est pas militant, mais pierre par pierre, film après film il abat les murs qui obstruent notre regard sur le monde en faisant en sorte que le politique ne soit pas autre chose que la vie. Le cinéma de Laurent Cantet demande du temps, mais pas nécessairement de gros moyens. Entre les murs est l’aboutissement de cette méthode de travail. Prendre le temps, dans le monde d’aujourd’hui et spécifiquement dans ce métier, est un acte séditieux. C’est un élan vers une réforme du système de fabrication des films, vers un renouveau, non plus formel mais sociologique dans l’Histoire du cinéma. Une nouvelle place pour le 7ème Art.
Laurine Estrade
MUSHI GONO
Message posté à la demande d'une spectatrice.
Bonjour,
Je me permets de vous retransmettre ce message en me disant que le blog de
L'Alhambra permettra peut-être à mon amie Célia de nouer des contacts utiles et
bénéfiques pour la réalisation de son projet.
Merci beaucoup
Christine Robert
Bonjour à tous,
Mushi Gøno est une histoire de danse, de voiture et d’accident.
Mushi Gøno est un moyen-métrage qui cherche des financements.
Je vous envoie, à tout hasard, la présentation du projet (que je réalise)... Peut-être connaîtriez-vous des producteurs généreux, des mécènes désintéressés (ou intéressés, d'ailleurs), des partenariats à créer? Posée ainsi, la question paraît naïve, mais sachez que Le Roi se meurt - notre précédent projet - a été intégralement financé ainsi: par un hasard.
N'hésitez donc pas à faire suivre, largement. Nous vous tiendrons bien sûr au courant.
Merci à vous,
Celia,
réalisatrice de Mushi Gøno et directrice de La Signor Clark Compagnie (association à laquelle il est d'ailleurs possible d'adhérer en écrivant à : elsignorclark@aliceadsl.fr )
Saisissez votre signature ici
Christine Robert * 5 rue Hélène Boucher * 62200 Boulogne-sur-mer
Synopsis
Quelques pas sur le trottoir, une voiture qui surgit, un choc. Puis plus rien.
C’est l’histoire d’une danseuse, mais elle se réveille à l’hôpital et apprend
qu’elle ne l’est plus, danseuse. Peut-être pourra-t-elle remarcher, un jour - et encore,
avec beaucoup de chance. Alors danser… Le diagnostic est imparable. Irrémédiable.
Les infirmières se penchent au-dessus d’elle, lui parlent, lui sourient ; elle, elle
ne bouge pas, ne parle pas, ne veut rien entendre. Son ami vient la voir, elle regarde
le plafond. Sa mère lui rend visite, elle garde les yeux fermés. Des policiers viennent
recueillir son témoignage, sa plainte peut-être, elle les congédie avec politesse. Les
fleurs changent sur la table de nuit, les séances chez le kinésithérapeute se
multiplient, les jours passent, mais elle reste là, regard droit devant, hermétique à ce
qui l’entoure. Peu importe les autres ; l’important, c'est de réussir à marcher. Alors
elle s’entraîne, seule dans sa chambre, elle répète les pas, un à un, ceux qui
permettent de tenir debout.
Et puis, un jour, elle part. Il suffit d’un détail de trop, d’une goutte d’eau dans
le vase, de quelques mots d’un médecin maladroit, pour qu'elle prenne la fuite – fuir
pour échapper aux bouquets de fleurs, aux boîtes de chocolat, aux blouses blanches,
aux souvenirs d’avant. Elle part comme on s’évade, clandestinement,
subrepticement, presque illégalement. Elle traverse des couloirs et des couloirs,
entend des cris, et ne se retourne pas : elle part, et tant pis pour ceux qu'elle laisse
derrière elle.
C’est l’histoire d’une fuite, un récit qui s’emballe. Clopine-clopante, cahinecahate,
elle sort de l’hôpital, s’enfuit dans la ville. Quitte à voler une poussette, s’il le
faut, pour aller plus vite. Quitte à dormir dehors, par terre, en bas d’un immeuble.
Quitte à se retrouver en garde à vue, face à un commissaire odieux, effrayant, à qui
elle refusera de dire son nom.
L’histoire devient déraisonnable. Quelqu'un de sensé n’agirait pas comme ça.
Quelqu'un de sensé n’irait pas frapper à la porte de celui qui l’a renversé, encore
moins s’installer chez lui. Oui mais… il ne s’agit pas de raison. Tout cela est juste une
question d’instinct, de survie.
Mushi Gøno 6
A partir de là, tout s’accélère. L’histoire se transforme en road-movie, la
danseuse force Ivan, ce « chauffard » à qui elle doit sa perte, à prendre la route avec
elle. La voiture roule, les kilomètres défilent, elle respire. Allongée sur la banquette
arrière, pieds au plafond, elle recommence à parler, à exister. Elle parle de « Mushi
Gøno », de Lettonie, d’Estonie et de Lituanie, raconte n’importe quoi, mais elle parle.
Elle devient envahissante, égoïste, mais elle vit.
L’échappée se teinte peu à peu de bizarrerie. Un portable se met à fredonner
en pleine nuit une musique que l’on tente d’oublier, les champs se peuplent de cours
d’aérobic, la police se fait de plus en plus présente. Au cours d’une dernière halte, les
fuyards se retrouveront pris dans une fête où la fanfare joue sans instruments, où la
chanteuse oublie de chanter. Ils se retrouveront dans une fête où, pour la première
fois, peut-être, il est à nouveau possible de danser.
Sauf si tout cela n’est qu’un rêve, un sursis de réalité…
Olivia Ross (photo de répétition)
Mushi Gøno 7
Note d’intention
Il est délicat d’écrire une note d’intention pour Mushi Gøno, de mettre des
mots là où ils ont été évités. Le fait même de résumer l’histoire me semble trompeur ;
si l’on voulait le faire avec les mots communs, cela pourrait ressembler à : une
danseuse devient handicapée à la suite d’un accident de voiture et, pour s’en sortir,
décide de quitter tout ce qui la relie à son ancienne vie. Seulement, ce n’est pas
vraiment cette histoire là que j’ai envie de raconter. Certes, il est question de
danseuse, mais nous ne la verrons jamais danser – nous ne connaîtrons même jamais
son nom. Certes, il est question de handicap, mais le mot ne sera jamais prononcé – et
le corps vacillant de l’héroïne ne devra évoquer au spectateur aucun handicap
médicalement identifiable. Certes, il est question de départ, mais aucune explication
psychologique n’est donnée – la notion même de « décision » est incertaine.
L’histoire est bien celle d’une danseuse devenue handicapée, mais elle ne peut
pas se dire avec ces mots là, extérieurs, figeant : dans Mushi Gøno, tout doit être perçu
comme du ressenti, de l’instinctif, dans une subjectivité presque fantasmatique. Il ne
doit pas s’agir d’un constat désespérant, désespéré, compassionnel, violemment
réaliste : plutôt que de montrer une réalité en cul de sac, j’aimerais raconter une
échappée fantasmée, profondément subjective. Chaque parcelle, chaque fragment du
film devra être tourné dans cette perspective là : si l’histoire est simple,
vraisemblable, tout y est vu à travers le prisme du fantasme, chaque instant y a un
arrière goût d’irréalité. Cette étrangeté s’annonce dès les premières images du film –
caméra subjective en contre-plongée sur un visage flou, souriant, inhumain, au
milieu d’un plafond blanc : l’hôpital, haut lieu potentiel du réalisme glauque, n’est ici
qu’une perception, subjective et impérieuse. L’insupportable de la situation n’est pas
décrit, il est ressenti. Il faut fuir.
La fuite est elle aussi de l’ordre du fantasme. C’est une envolée, un
emballement, où chaque chose prend de l’ampleur : au fur et à mesure de l’échappée,
la musique s’envolera, se « lyrisera », prendra de plus en plus d’importance ; la
caméra se mettra en mouvement, les plans s’enchaîneront de plus en plus
rapidement ; le monde se colorera, tache par tache, rencontre après rencontre,
jusqu’au feu d’artifice de la scène de fin – enfin, d’ « avant-fin ». En effet, si le début
est très précis, tendu, ascétique, le scénario laisse de plus en plus de place aux « àcôtés
», au fourmillement ; ainsi, la fête finale, qui ne tient que quelques pages dans le
scénario, sera en réalité une longue scène, où la simplicité de l’histoire centrale sera
Mushi Gøno 8
habillée par la foule (Camélia ou le Signor Clark chantant, bien sûr, mais aussi un
enfant terminant les fonds de verre, une femme dansant sur la table, une autre
cherchant désespérément ses clés, etc. – autant de micro-scènes non indiquées dans le
scénario, car je souhaite élaborer ce délire joyeux avec les acteurs, à partir de leurs
propositions… comme c'est d’ailleurs le cas pour beaucoup des personnages
secondaires de Mushi Gøno). Le film tout entier doit être tendu vers cette explosion
finale, comme une machine qui s’emballe, une progression impossible à arrêter.
ELLE – ce personnage sans nom, cette danseuse sans danse - avance, coûte que coûte.
Le film n’est rien d’autre que cette avancée fantasmée, commençant là où
d’autres se terminent, dans l’après, le trop tard. Cette danseuse, nous ne la verrons pas
danser, mais nous la verrons boiter, claudiquer, vaciller… s’étirer, lutter, se
redresser… C’est à la fois peu et beaucoup : certes, le récit est linéaire, le point de vue
unique, mais il s’agit d’une échappée nécessaire, d’une question de survie. Cette
relative simplicité narrative est contrebalancée par le foisonnement du monde
entourant cette danseuse qui ne danse plus, du monde tel qu’elle le voit – excessif,
musical, violent et coloré. Le principal enjeu de réalisation se situe là, dans la
construction d’un univers, dans l’édification de son monde à ELLE, à la fois divers et
cohérent, simple et fourmillant. Personnages secondaires fantasmatiques, espace
sonore envahissant, travail important sur la lumière (dans une perspective presque
expressionniste), image souvent au bord du décadrage,… tout doit concourir à faire
de Mushi Gøno un univers à l’arrière goût de bizarrerie, une réalité jouée, filmée,
ressentie comme un songe – un cauchemar, peut-être.
Dernière précision : pour construire cet univers foisonnant, il me semble
important de s’appuyer sur des énergies diverses et contrastées, sur une équipe
ayant envie de travailler ensemble, prête à s’investir, à essayer, à proposer ; je
souhaite que Mushi Gøno soit un vrai film de troupe, nourri de propositions
multiples, pensé dans sa globalité et sa cohérence… c'est-à-dire avec une répartition
de rôles la moins fragmentée possible et un important travail commun. Bien sûr, ces
dernières considérations ne sont pas vraiment ce que l’on attend d’une note
d’intention, mais dire comment j’ai envie de réaliser Mushi Gøno me paraît bien plus
important que d’en expliquer le pourquoi – ce dont je suis d’ailleurs incapable.
Pourquoi cette histoire ? Pourquoi une danseuse ? Pourquoi ce départ ? Pourquoi
Ivan ? Pourquoi la Symphonie 40 ? Pourquoi Tomate et non Artichaut ? Je ne sais
pas. Mais c’est important.
Celia Daniellou-Molinié
Mushi Gøno 9
Mushi Gøno : un film sur le handicap ?
Olivia Ross (photo de répétition)
Mushi Gøno est-il un film sur le handicap ? Bien sûr… et pourtant, pas
vraiment.
Mushi Gøno n’est pas un film à message, une œuvre ayant pour but de
sensibiliser le public à une cause.
C’est un film à hauteur d’homme, ou plutôt de jeune femme. Un film de
regard, d’impressions, où la subjectivité règne en maître.
Mushi Gøno raconte une histoire – l’histoire d’ELLE – et rien de plus. Sa
souffrance intolérable, sa fuite, son progressif retour à la vie.
ELLE n’est pas un emblème, pas un symbole. C’est un personnage courageux
et insupportable, drôle et égoïste, magnifique et détestable – avant tout, singulier.
Mais c’est aussi, d’une certaine façon, un acte engagé que de raconter une
histoire que le handicap fait basculer sans que le personnage en devienne symbole,
sans noyer celui-ci sous un discours, qu'il soit misérabiliste, provocateur ou
angélique. Dans Mushi Gøno, le handicap doit devenir pour le spectateur une réalité
singulière, subjective, parfois douloureuse, parfois drôle, parfois sans importance –
bref, vécue. Simplement vécue.
Celia Daniellou-Molinié
Mushi Gøno 10
Regards croisés sur le projet
Pourquoi ce projet ? et comment ? Plusieurs membres de l’équipe apportent
leur réponse…
Simon Legré – Assistant de production
Elève à l’Institut des Hautes Etudes d’Amérique Latine, après un Master de cinéma à Montréal.
« Certaines aventures obéissent à une nécessité, s’imposent à vous comme une évidence. Je
connais Celia depuis cinq ans et pourtant ni elle ni moi n’avions jamais réuni nos énergies au
profit d’un projet commun. Lorsqu’elle m’a envoyé son scénario, je me suis surpris à être
traversé de façon immédiate et très intime par du mouvement. D’abord cette grande
sensibilité à la douleur d’un monde qui a perdu son coloris. Puis cet ordre très particulier
dans les sons et les sensations qui s’en dégageaient. J’ai aimé cette façon dont, comme un train
qui déraille, l’histoire en cachait une autre : à partir d’un postulat concret, le récit ouvre une
brèche très abrupte et, sans nous demander notre avis, nous embarque dans une ballade
sensorielle, un arrière-monde bigarré, barré, aux reflets oniriques. Une telle transition est, je
trouve, une perspective réjouissante. Ce n’est pas une histoire narcissique dans laquelle Celia
m’a proposé de mettre les pieds. Elle provient de l’imaginaire fertile et sagace de quelqu’un
animé d'un désir de route qui va au delà des balises en vigueur. Je suis très heureux de
pouvoir être l’un des accoucheurs de cette exigence de vie-là. »
Pierre Carrive – Acteur (rôle du Signor Clark)
Comédien. A travaillé notamment au théâtre avec Didier Flamant et François Cervantès et, au cinéma,
avec Yves Hanchar, Maud Alpi, Luc Besson,…
« Il y a parmi nous des « empêchés ».
Empêchés depuis toujours ou suite aux soubresauts de la vie.
Empêchés dans leur corps ou dans leur tête ou les deux.
Certains ont renoncé, d’autres luttent avec éclat ; de manière
si évidente, si naturelle, qu'on ne peut même plus parler de
lutte. Ils s’inventent leur propre danse, singulière.
La jeune femme de Mushi Gøno est de ceux-là, Celia est de
ceux-là.
Une danse avec elles ne se refuse pas !
Mushi Gøno 11
Laure Cottin – Conseillère image
Elève aux Arts Décoratifs de Paris, section vidéo. A réalisé de nombreux courts-métrages.
« Dans Mushi Gøno, tout reste à faire… Si le scénario divulgue quelques indices au travers
de personnages étranges comme la vieille femme dans le bus et son sourire énigmatique, le
professeur d’aérobic ou encore la femme aux flacons et sa nonchalance érotique,… l’image
reste floue. J’ai l’intuition qu’elle doit d’abord s’inspirer de l’univers que charrient ces
personnages apparemment seconds, pour ensuite construire autour, le monde d’ELLE.
Il s’agit de créer un univers intérieur : celui d’ELLE, il faut chercher la transcription de ce
monde avec les sons ressentis par son corps, avec les tons de l’image plus ou moins saturés ou
surexposés, ne pas avoir peur de l’invraisemblance ou de l’incohérence, nous naviguons sur
un territoire où la norme est étrangère.
Il est intéressant que la caméra accompagne physiquement l’évolution de la mobilité du corps
d’ELLE : les premières scènes d’hôpital sont d’un blanc surexposé qui mange le corps, les
plans sont immobiles, englués dans le blanc de la chambre mais, au fur et à mesure que
l’héroïne retrouve la mobilité de son corps, la caméra s’autonomise et évolue avec elle en allant
à la rencontre de personnages étonnants.
Dans l’éclatement final, le cadre est inondé d’une faune truculente, un carnaval de tissus, de
couleurs et de faces peintes où tout devient mobile, exubérant ; c’est un monde fellinien qui
explose avec des corps généreux et joyeux qui finissent par ôter la blancheur médicale du
visage d’ELLE et enfin, un peu, lui teinter les joues. »
Caroline Marcadé – Conseillère chorégraphique
Chorégraphe, professeur de danse au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris
« Qu’est-ce que le corps sans le mouvement intérieur qui l’anime ? Qu’est-ce que la danse
sans la conscience de la vie ?
En lisant le scénario de Mushi Gøno, j’ai éprouvé la réalité de ces deux questions. L’auteur
porte un regard aigu sur le corps « à l’arrêt » et sur son double, le corps « en marche ». Le
soin infini à décrire le passage d’un mouvement à un autre, d’une réalité à une autre, le
rythme et la musicalité qui s’en dégagent fabriquent un langage personnel d’une grande force.
Dans chaque situation, la netteté des détails visuels et la rigueur concise des dialogues
frappent. Ici, les images parlent, le désir de vivre se transforme en danse du désir. Comme si
marcher était bien la première de toutes les danses. Comme si partir était la plus élégante des
révérences.
La chorégraphe que je suis ne peut qu’être admirative devant le regard essentiel de Celia
Daniellou-Molinié : son regard est unique et vrai.
Sollicitée pour mon aide à la chorégraphie du générique de début, je suis touchée d’imaginer
collaborer à un projet à la fois singulier et universel dans lequel la place du corps occupe la
place d’un premier plan. L’actrice qui joue le personnage principal a un travail physique très
délicat à fournir. La subtilité, la grâce et l’émotion sont les outils qui serviront à son
interprétation. »
Mushi Gøno 12
Francis Ressort - Acteur (rôle d’Ivan)
Comédien au Théâtre du Soleil de 1999 à 2008, a joué
également dans de nombreux courts-métrages et
téléfilms.
« Pourquoi avoir choisi Mushi Gøno ?
J’ai rencontré Celia Daniellou-Molinié, il y a de
cela presque deux ans, au Théâtre du Soleil. Déjà
son caractère et sa personnalité avaient attiré mon
attention, et quand elle vint me proposer de jouer
dans son futur film, j’ai accepté de lire son scénario
en sentant que, de toute façon, j’accepterais sa
proposition.
Après lecture, l’évidence confirmée, je me suis senti
étonnamment proche du personnage d’Ivan.
Sa difficulté à vivre le rend étrange mais touchant,
et sa solitude, mystérieux.
La solitude, voilà la clé. Petit à petit c’est elle qui le tue…C’est la seule qui l’accompagne et
qui prend les décisions à sa place.
Quand Elle frappe à sa porte, Ivan refuse, panique.
Et c’est Elle qui, cette fois, lui rentre dedans.
J’ai aimé de suite la langue et l’économie du scénario qui permettent une dissection des
sentiments et nous renvoient à notre histoire personnelle sans jamais tomber dans la facilité et
le cliché. Et cette résonance –même les silences ont un écho- m’a accompagné très longtemps
après la lecture, ce qui est pour moi une preuve irréfutable de la justesse de mon choix. »
Olivia Ross - Actrice (rôle de ELLE)
Elève à la Guildhallschool of Music and Drama (Londres). A
également joué dans Tout est pardonné et Le père de mes enfants,
longs métrages de Mia Hansen-Love, Je l’aimais de Zabou
Breitman et Le voyage au Japon de Thibaut Gobry.
« Il y a d’abord une histoire d’amitié « artistique » avec
Celia Daniellou-Molinié… Nous avons déjà travaillé
ensemble, notamment au théâtre, et avons le désir
réciproque de poursuivre notre collaboration dans divers
champs d’action et autant que l’avenir nous le permettra.
Et puis bien sûr il y a le scénario de Mushi Gøno… J’ai
tout de suite été enthousiasmée à l’idée d’interpréter le rôle
de ELLE. La danse, ou, disons, le fantôme de la danse, et le
handicap représentent une implication corporelle passionnante pour un comédien.
D’autre part le personnage de ELLE me parle, pour dire les choses simplement. Ce qu’elle a de
buté, sa dureté même parfois, qui contraste avec ses accès d’excitation joyeuse et presque
enfantine sont des éléments que je comprends sans difficulté. La détermination silencieuse des
Mushi Gøno 13
premiers temps du film, autant que la curiosité ou l’exaltation vertigineuse dont elle fait
preuve plus tard ont une cohérence qui fait sens pour moi d’une manière intérieure, profonde,
quasi secrète.
Alors évidemment il y a l'envie de m’engager entièrement dans ce projet qui promet une
aventure cinématographique, artistique et humaine ; une envie si évidente qu'il devient
presque difficile d’en parler. »
Anaïs Tondeur – Costumière
Etudiante en design textile à la Central Saint Martin’s School (Londres). Nombreux stages (John
Galliano, Théâtre du Soleil, etc.). Assistante costumière au Théâtre du Rond-Point en 2006.
« Si le travail sur les costumes devait être décrit, je parlerais avant tout de couleurs. Reflet de
la fuite, elles accompagnent les personnages principaux en progressant d’une palette de
blancs, de beiges, de gris, au camaïeu éclatant et éclectique de la fête finale. Cette dernière
explosion chromatique aux accents d’un film de Kusturica n’est pas une irruption brutale, elle
est suggérée en amont par les couleurs vives des costumes des personnages secondaires, de
certaines apparitions fugitives… Deux petites filles en imperméable rouge traversent une rue
grise… Au loin, un groupe de gens s’essaient à l’aérobic dans des survêtements aux tons
bollywoodiens…
Les costumes sont pensés et développés en collaboration avec Esther Jammes, responsable des
décors. L’univers esquissé autour de chaque personnage sera aussi discuté, ouvert aux
propositions des acteurs. Je crois en l’importance d’un projet construit à plusieurs mains, et
Mushi Gøno m’en offre une belle occasion. »
Mushi Gøno 14
Croqui s pr éparatoi re s aux costume s (Anaï s Tondeur)
Mushi Gøno 15
La Signor Clark Compagnie
La Signor Clark Compagnie, association loi de 1901, est une troupe de théâtre
et de cinéma fondée officiellement en janvier 2008, après plusieurs projets menés de
concert par ses membres (mise en scène du Roi se meurt d’Eugène Ionesco en 2006,
création d’ateliers en 2006-2007 et 2007-2008, etc.). Chaque membre de la compagnie
est impliqué, d’une manière ou d’une autre, dans Mushi Gøno – projet porté par le
désir de faire un véritable « film de troupe », au sens théâtral du terme (voir note
d’intention).
Accordant une certaine importance à l’inscription des pratiques artistiques
dans l’espace civique, nous souhaitons également profiter d’un tournage comme
celui de Mushi Gøno pour faire découvrir à des personnes n’y ayant pas accès
habituellement les processus de fabrication de l’image : ainsi, lors de certaines
séquences, un ou plusieurs membres de la troupe prendront en charge quelques
figurants afin de les initier au fonctionnement d’un tournage (ces figurants pourront
être « recrutés » dans des ateliers animés par ailleurs par les membres de La Signor
Clark Compagnie, en partenariat avec des structures éducatives : centres sociaux,
lycées, etc.).
Statuts de l’association (extrait)
ARTICLE 2 : Objet – Réalisation de l’objet
Cette association a pour but la création, la production et la diffusion de projets
artistiques, ainsi que l’inscription des pratiques artistiques dans l’espace civique.
Dans cet esprit l’association pourra:
· organiser des spectacles ou manifestations publiques ;
· produire des films, spectacles audiovisuels, etc. ;
· mettre en place des opérations culturelles ou sociales ;
· organiser des ateliers, des formations ;
· éditer des livres, journaux, revues,... ;
· organiser des débats ;
· et plus généralement, toute opération de nature à favoriser, directement ou
indirectement, les buts poursuivis par l’association, son extension et son
développement.
Mushi Gøno 16
Le Roi se meurt, une expérience fondatrice
La mise en scène du Roi se meurt, pièce
d’Eugène Ionesco, fut le premier projet
commun de ceux qui décidèrent, ensuite, de
former ensemble La Signor Clark Compagnie
pour un projet artistique au long cours.
Le Roi se meurt, d’Eugène Ionesco
Représentations en juin 2006 au Théâtre Kantor
(Lyon) et à la Halle des Epinettes (Issy-les-
Moulineaux).
Mise en scène Celia Daniellou-Molinié
Assistée de Esther Jammes
Musique Jean-Marc Serre
Avec Jean-Paul Ramat, Olivia Ross, Quentin Lévi,
François-Xavier Rouyer, Caroline Dumas de Rauly,
Frédéric-Pierre Saget
Et Mathilde Carrive, Simon Daireaux, Elie
Khalfallah
Le regard d’une spectatrice
Agnès Sourdillon*, dans une
lettre à Celia Daniellou-Molinié
« Je viens par ce petit mot dire […]
mon émerveillement face au travail de
votre compagnie […]. J’espérais, sans
doute, la fraîcheur, l’énergie et la
liberté de ton d’une jeune troupe…
mais c’est bien plus encore qui a
retenu mon attention et embarqué
mon émotion […] : une ferveur où le
spectaculaire ne cède en rien sur la
profondeur de l’œuvre écrite, où la
simplicité et le dénuement s’avère le
chemin le plus direct pour recueillir la
parole, l’histoire qui s’y compte, sa
poésie, l’élégance vive et sans
encombrement des gestes des
comédiens.
La lumière des costumes éblouit à elle
seule et suffit à la magie : tout alors
nous mène au plus près des acteurs,
comme si on avait notre dose d’étoiles
et que ce qui requiert alors notre
attention est l’œuvre servie, et cette
expérience à vivre ensemble, avec le
public.
Dans son dernier livre, Lumières du
Corps, Valère Novarina écrit : « Il est
beau que le mot attraction nous mène
à la fois au cirque et aux planètes ». Il
y avait cirque et planètes dans cette
petite salle d’Issy-les-Moulineaux,
votre public les voyait ; et je vous
souhaite de tout cœur d’autres publics,
d’autres villes où trimballer ce
spectacle qui sait aller droit au but et
en couleurs ! […] »
* Agnès Sourdillon est
comédienne. Elève d’Antoine
Vitez, elle a joué notamment sous
la direction de Stéphane
Braunschweig, Bernard Sobel,
Valère Novarina, Didier Besace,
Patrice Chéreau, Charles
Tordjman,…
Mushi Gøno 17
Curriculum Vitae
Celia Daniellou-Molinié
FORMATION
2005-2008 Elève à l’Ecole Normale Supérieure Lettres et Sciences Humaines, en
Master d’Etudes Théâtrales
Juin 2005 Obtention du concours d’entrée de l’Ecole Normale Supérieure
Lettres et Sciences Humaines
2003-2005 Etudiante en Hypokhâgne et en Khâgne au lycée de Sèvres
DIPLOMES
Juin 2006 Obtention d’une licence de lettres modernes
Juin 2003 Diplôme du Baccalauréat Economique et Social, mention Très Bien
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Projets 2008-2009 Co-mise en scène de Jean et Béatrice, de C. Fréchette.
Actrice principale de Garde tes singes en Enfer, moyen-métrage de
Caroline Dumas de Rauly.
2007-2008 Création et animation d’un atelier de théâtre au Lycée-EREA
Toulouse Lautrec (Vaucresson).
Stage à France Culture (service fictions)
Eté 2007 Assistante réalisatrice d’ Alphonsine, court-métrage de Caroline
Dumas de Rauly.
2006-2007 Stage au Théâtre du Soleil.
Création et animation d’un atelier de cinéma à la Maison d’Enfants
Clair-Logis (Paris). Réalisation de courts-métrages avec les enfants.
Février 2007 Actrice (rôle principal) dans Fuites, moyen-métrage de François-
Xavier Rouyer, produit par la Production des Hommes-Poissons.
2006 Mise en scène du Roi se meurt, de Ionesco, au sein de La Production
des Hommes-Poissons.
2003 et 2001 Stages à France Inter.
2002-2003 Participation à la création d’un spectacle de théâtre-forum avec la
Compagnie NAJE
DIVERS
Janvier 2008 Fondation et direction de La Signor Clark Compagnie (troupe de
théâtre et de cinéma)
soirée RESF
Ce message pour remercier tous ceux qui étaient présents lors de la soirée d'hier consacrée au Réseau Education Sans Frontières.
Si vous souhaitez communiquer avec le réseau calaisien, le rejoindre dans ses actions, lui amener un peu de votre temps ;
Parce qu'il est urgent de réagir ,
Parce que nous devons être de plus en plus nombreux à le faire,
resf.calais@gmail.com
http://www.educationsansfrontieres.org/

Rêve d'usine sort en DVD
Rêve d’usine
réalisé par Luc Decaster
Septembre n’est plus mai, et la rentrée n’a cette année plus grand chose de militant. Rêve d’usine, de Luc Decaster, a donc tout, d’un mauvais rêve d’usine, qui nous rappelle au souvenir des laissés pour compte des plans sociaux. L’usine de matelas Epeda de Mer ferme ses portes et licencie, alors que le mois précédent, les ouvriers faisaient encore des heures supplémentaires. Peu à peu, l’usine et leurs vies se vident, le temps autrefois séquencé s’étire, se dilue, le dialogue avec la machine et les cadences, se transforme en monologues face caméra. Luc Decaster capte subtilement et humainement toute cette longue résignation.
Les ouvriers de l’usine de fabrication Epeda vont être licenciés, l’usine va fermer, pour laquelle ils ont travaillé la majeure partie de leur vie, et sans laquelle aucun avenir ne semble possible. On délocalise. Luc Decaster filme au moment où tout ça commence, capte les paroles, qui, de révoltées, mobilisées, construites, deviennent progressivement tristes puis résignées. 300 ouvriers occupent l’usine, et c’est long, très long, bientôt sans beaucoup d’espoir. On découvre les ressources pas très humaines des ressources humaines : « y a des gens au bâtiment qui sont ouvriers on leur a proposé des postes de vendeur ; toi tu es vendeur on te propose un poste de couturier : tu vois la supercherie ! » ; les lettres de licenciement envoyées le 31 décembre ; la bataille judiciaire perdue d’avance.
L’engagement est du côté des ouvriers, dont on découvre la noblesse : le respect du travail bien fait alors que l’entreprise bâcle ses nouveaux matelas (fameuse séquence au salon d’exposition où les ouvriers débarquent pour faire une contre-publicité à Epeda), l’attachement au travail, le sens de la solidarité, le courage. Derrière les actions fortes, comme le footing-manifestation dans les rues de la commune, il y a les visages et les histoires de chacun : « c’est beau à vivre… c’est tellement vrai et juste… y a une beauté dans cette lutte » dit un ouvrier.
Cependant, des images se télescopent : comme dans Le dos au mur de Jean-Pierre Thorn, ou Classe de lutte de Bruno Muel et Simone Nedjma, on retrouve dans Rêve d’usine des images du cinéma militant, et notamment ici le renversement carnavalesque du patron qui est humilié et lynché verbalement par ses propres ouvriers à bout de nerfs. La scène clé de Rêve d’usine oppose les ouvriers à M. Guérin, le directeur de l’usine, qui va trinquer pour tous les grands patrons. « Prends le micro puis explique-toi au moins ! », lui crie-t-on, et lorsqu’il tente de parler, c’est une ouvrière qui se dresse face à lui pour lui crier : « On a travaillé 28 ans ici, on a tout construit ici, on a nos petits-enfants ici… vous croyez qu’on peut pas être amers un peu… nous on demande pas mieux que de travailler… on a tout mis dans cette putain d’usine… mettez vous dans notre peau un petit peu… vous êtes prêt à lâcher tout, vos enfants, vos petits-enfants ? c’est pas possible ! ».
Puis un ouvrier agresse directement M. Guérin en s’appuyant sur son épaule pour contester les entourloupes juridico-administratives de l’entreprise : « il vient d’où l’argent ? Epeda ou Epefa ? »… avant de nettoyer cette même épaule d’un revers de main, à cause d’un sursaut de respect hiérarchique ou de politesse.
C’est un documentaire parce que, comme les réalisateurs le disent très bien dans les bonus du DVD, il y a entre les plans comme des points de suspension : il manque la voix off, les cartons militants, le message. Mais au moins, on sait : une usine, ce sont des salariés, des hommes avec des vies de famille, qui ont tous beaucoup investi d’eux-mêmes dans l’usine, qui pleurent quand il va falloir partir. Car un documentaire, c’est moins un message que des hommes qu’on filme et des situations qu’on observe : comme le dit Luc Decaster, Rêve d’usine donne accès à une compréhension pas tant de l’histoire de ces ouvriers que d’une « situation d’abandon ». Or ces employés licenciés, sans formation, sans possibilité de reconversion, sont les laissés pour compte d’une histoire abrupte, et voués à l’oubli. Le syndicat, impuissant, contesté, inutile, a tout perdu, ne fait plus qu’enjoindre les salariés de signer les accords peu glorieux signés avec la direction. Le film se clôt sur un plan qui blanchit, où disparaissent et les hommes et les choses, comme un gâchis non anticipé. Et des chiffres, comme un bilan sinistre et comptable, alors que c’étaient les gestes et le savoir-faire ouvrier qui ouvraient le film.
Romain Lecler
Le Silence de Lorna
Un message d'Arnaud :
pour des raisons indépendantes de notre (meilleure) volonté
et contrairement à ce que nous avons annoncé,
nous ne pouvons poursuivre l'exploitation du film LE SILENCE DE LORNA
au-delà du 23 septembre
*




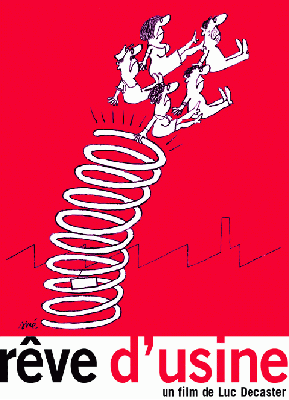
Commentaires