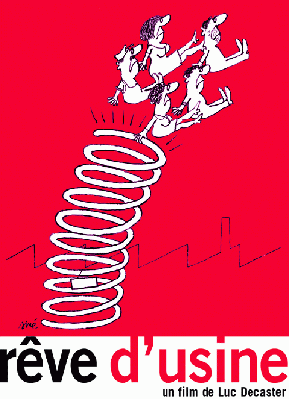Auteur : leblogdesamis
Date de création : 08-08-2008
Rêve d'usine sort en DVD
Rêve d’usine
réalisé par Luc Decaster
Septembre n’est plus mai, et la rentrée n’a cette année plus grand chose de militant. Rêve d’usine, de Luc Decaster, a donc tout, d’un mauvais rêve d’usine, qui nous rappelle au souvenir des laissés pour compte des plans sociaux. L’usine de matelas Epeda de Mer ferme ses portes et licencie, alors que le mois précédent, les ouvriers faisaient encore des heures supplémentaires. Peu à peu, l’usine et leurs vies se vident, le temps autrefois séquencé s’étire, se dilue, le dialogue avec la machine et les cadences, se transforme en monologues face caméra. Luc Decaster capte subtilement et humainement toute cette longue résignation.
Les ouvriers de l’usine de fabrication Epeda vont être licenciés, l’usine va fermer, pour laquelle ils ont travaillé la majeure partie de leur vie, et sans laquelle aucun avenir ne semble possible. On délocalise. Luc Decaster filme au moment où tout ça commence, capte les paroles, qui, de révoltées, mobilisées, construites, deviennent progressivement tristes puis résignées. 300 ouvriers occupent l’usine, et c’est long, très long, bientôt sans beaucoup d’espoir. On découvre les ressources pas très humaines des ressources humaines : « y a des gens au bâtiment qui sont ouvriers on leur a proposé des postes de vendeur ; toi tu es vendeur on te propose un poste de couturier : tu vois la supercherie ! » ; les lettres de licenciement envoyées le 31 décembre ; la bataille judiciaire perdue d’avance.
L’engagement est du côté des ouvriers, dont on découvre la noblesse : le respect du travail bien fait alors que l’entreprise bâcle ses nouveaux matelas (fameuse séquence au salon d’exposition où les ouvriers débarquent pour faire une contre-publicité à Epeda), l’attachement au travail, le sens de la solidarité, le courage. Derrière les actions fortes, comme le footing-manifestation dans les rues de la commune, il y a les visages et les histoires de chacun : « c’est beau à vivre… c’est tellement vrai et juste… y a une beauté dans cette lutte » dit un ouvrier.
Cependant, des images se télescopent : comme dans Le dos au mur de Jean-Pierre Thorn, ou Classe de lutte de Bruno Muel et Simone Nedjma, on retrouve dans Rêve d’usine des images du cinéma militant, et notamment ici le renversement carnavalesque du patron qui est humilié et lynché verbalement par ses propres ouvriers à bout de nerfs. La scène clé de Rêve d’usine oppose les ouvriers à M. Guérin, le directeur de l’usine, qui va trinquer pour tous les grands patrons. « Prends le micro puis explique-toi au moins ! », lui crie-t-on, et lorsqu’il tente de parler, c’est une ouvrière qui se dresse face à lui pour lui crier : « On a travaillé 28 ans ici, on a tout construit ici, on a nos petits-enfants ici… vous croyez qu’on peut pas être amers un peu… nous on demande pas mieux que de travailler… on a tout mis dans cette putain d’usine… mettez vous dans notre peau un petit peu… vous êtes prêt à lâcher tout, vos enfants, vos petits-enfants ? c’est pas possible ! ».
Puis un ouvrier agresse directement M. Guérin en s’appuyant sur son épaule pour contester les entourloupes juridico-administratives de l’entreprise : « il vient d’où l’argent ? Epeda ou Epefa ? »… avant de nettoyer cette même épaule d’un revers de main, à cause d’un sursaut de respect hiérarchique ou de politesse.
C’est un documentaire parce que, comme les réalisateurs le disent très bien dans les bonus du DVD, il y a entre les plans comme des points de suspension : il manque la voix off, les cartons militants, le message. Mais au moins, on sait : une usine, ce sont des salariés, des hommes avec des vies de famille, qui ont tous beaucoup investi d’eux-mêmes dans l’usine, qui pleurent quand il va falloir partir. Car un documentaire, c’est moins un message que des hommes qu’on filme et des situations qu’on observe : comme le dit Luc Decaster, Rêve d’usine donne accès à une compréhension pas tant de l’histoire de ces ouvriers que d’une « situation d’abandon ». Or ces employés licenciés, sans formation, sans possibilité de reconversion, sont les laissés pour compte d’une histoire abrupte, et voués à l’oubli. Le syndicat, impuissant, contesté, inutile, a tout perdu, ne fait plus qu’enjoindre les salariés de signer les accords peu glorieux signés avec la direction. Le film se clôt sur un plan qui blanchit, où disparaissent et les hommes et les choses, comme un gâchis non anticipé. Et des chiffres, comme un bilan sinistre et comptable, alors que c’étaient les gestes et le savoir-faire ouvrier qui ouvraient le film.
Romain Lecler