Article paru dans le Sarkophage de
janvier 2009

La crise financière tombe décidément bien mal. Au delà
des gigantesques pertes qu'elle provoque et du chaos dans lequel elle plonge
l'économie, elle marque aux yeux du public l'échec cuisant des politiques
néo-libérales. Elle survient au moment même où la sphère de la finance
s'apprêtait à gagner un terrain considérable, en particulier sur le plan
idéologique. Comment? Grâce à l'alibi de la crise environnementale, en imposant
le marché dérégulé à tous les étages où il n'était pas encore
présent.
Pour la communauté internationale, le problème du
changement climatique relève de la quadrature du cercle. La dérégulation bat son
plein. Le libre-échange ne cesse de progresser et d'accomplir le transfert de
pouvoir du politique vers les multinationales. Les mots d'ordre sont « moins
d'Etat », « pas de taxe », « pas d'entrave au commerce ». L'Organisation
mondiale du commerce (OMC) s'emploie à supprimer toute barrière commerciale sans
jamais se soucier de formation des prix, de dumping ou de cohérence dans les
politiques monétaires.
Dans les années 70, les grandes puissances économiques
avaient déjà apporté leur réponse à l'émergence des préoccupations
environnementales dans le débat public. Il s'agissait bien-sûr du développement
durable, qui évacuait toute réflexion sur le contenu de la croissance et
confiait la résolution des problèmes à la techno-science et aux entreprises
elles-mêmes, censées s'auto-responsabiliser. Avec le résultat que l'on sait, la
dégradation des indicateurs environnementaux étant tout à fait proportionnelle
au verdissement des rapports d'activité.
Malheureusement, la crise climatique est telle que ce
maquillage ne suffit plus. Alors, que faire? Contraindre les grandes
entreprises? Re-discipliner la finance mondiale? On voit mal comment, puisque
tout est mis en oeuvre depuis des années pour leur laisser le champ libre. Il
faut donc trouver une autre solution. Ce sera le marché des droits à polluer.
Souvent perçu et présenté comme quelque chose de très
complexe, ce système est en fait assez simple. On attribue aux pollueurs des
droits à émettre des gaz à effet de serre (des quotas), l'unité de base étant la
tonne de dioxyde de carbone. On « titrise » en quelque sorte ces droits et l'on
permet l'échange de ces titres sur un marché spécifique, appelé marché du
carbone. Les entreprises doivent assurer un équilibre comptable en fin
d'exercice entre leurs émissions réelles de polluants, inscrites au passif, et
le volume de droits à polluer qu'elles détiennent, inscrites à l'actif.
Ce principe n'est pas seulement injuste du fait qu'il
transforme en droit un état de fait (la pollution historique des industriels),
il est également dangereux. Car évidemment, ce marché est très largement
dérégulé. Il n'est pas réservé aux seules entreprises. Il est ouvert aux fonds
spéculatifs, aux fonds de pensions, aux grandes banques d'affaires qui voient là
une nouvelle opportunité d'engranger des profits faciles en achetant le quota le
moins cher possible et en le revendant le plus cher possible.
Cette décision prise en l'absence de tout débat
démocratique lors des négociations du protocole de Kyoto constitue une victoire
des pouvoirs économiques. La crise écologique sera gérée par le marché. Donc,
sans contrainte réglementaire forte. Kyoto n'est pas le succès environnemental
que l'on a essayé de nous présenter, il s'agit d'un échec politique terrible.
Cette percée du marché sur le terrain de l'écologie marque la fin de l'ère du
développement durable et l'entrée dans l'écolo-libéralisme.
Qui plus est, ce marché du carbone ne se limite pas à la
sphère privée. Premièrement, une partie importante des fonds d'investissement
dédiés aux droits à polluer est constituée d'argent public. Le premier
gestionnaire au monde de fonds carbone, la Banque mondiale, possède un
portefeuille de deux milliards de dollars dont près de la moitié provient
d'Etats. Deuxièmement, les quotas sont distribués par les pays aux gestionnaires
des principales sources fixes d'émission. Ceci nécessite la création de Plans
nationaux d'allocation des quotas (PNAQ), dans lesquels nous trouvons des
collectivités. En France, par exemple, les Communautés Urbaines de Bordeaux,
Lille et Brest, les centres hospitaliers de Poitiers, Angers, Dijon, Caen,
Limoges, Nancy, Bordeaux, Saint-Etienne, les Universités de Dijon, Paris-Sud et
Rennes I… possèdent des systèmes de chauffage dont la taille les place dans le
PNAQ. Les responsables de ces établissements devront eux aussi « gérer leurs
quotas » et, sans doute, en acheter en Bourse.
Mais ceci n'est qu'un début. D'une part, les « projets
domestiques » vont étendre ce principe à des secteurs encore non couverts :
transports, agriculture, bâtiment,... D'autre part, une réflexion est engagée
sur des droits à polluer individuels. Comme son nom l’indique, il s'agit de
délivrer à chaque citoyen un volume annuel de droits. Ces quotas seront crédités
sur une carte à puce, et le « compte-CO2 » sera débité lors des achats d’énergie
primaire : plein d’essence ou de la cuve de fuel, acquittement d’une facture
d’électricité… Pour cette raison, le dispositif est souvent appelé « carte
carbone », formule plus politiquement correcte que celle de « droits à polluer
individuels ». En cas de déficit, les unités supplémentaires seront acquises sur
des places boursières, bien évidemment. Autant dire qu’avec un tel dispositif,
il vaut mieux être ingénieur à Barcelone et habiter près de son lieu de travail
plutôt qu’être chômeur à Lille, propriétaire d’une vieille voiture et locataire
d’une maison mal isolée…
L'acceptation de cette « carte carbone » qui nous sera
bientôt présentée prendrait un sens terrible. Elle instituerait d'une part le
droit à polluer payant pour les riches en lieu et place des réductions
obligatoires qui devraient leur être réclamées, et elle reporterait l'essentiel
du coût de la pollution sur les pauvres qui seraient, proportionnellement à
leurs revenus, les plus touchés. Or, ces derniers ne disposent que d'étroites
marges de manoeuvre dans leur vie quotidienne pour réduire leur impact
écologique. Rappelons par exemple que la consommation d'énergie des ménages
réagit très faiblement à la hausse du prix. Une augmentation de 10 % des tarifs
génère une baisse de la consommation d'au maximum 1,5%. Le pauvre (voire même le
« non-riche ») n'a malheureusement pas les moyens d'acheter une Smart chez son
concessionnaire Mercedes favori ou d'investir dans le dernier modèle de
chaudière économe.
Il est particulièrement inquiétant que des écologistes
soutiennent cette aberration anti-sociale au motif qu'elles représenteraient un
progrès pour l'environnement. Nous devons y voir l'une des grandes réussites des
néo-libéraux, qui ont habilement fait l'éloge du comportement individuel pour
mieux déconstruire les cadres collectifs. Le discours du « tous coupables »,
même s'il n'est pas fondamentalement faux, est amplifié jusqu'à la caricature
pour masquer le recul du politique. Ainsi, on oublie de préciser que certains
sont nettement plus coupables que d'autres, et que le rôle des pouvoirs publics
est bien de garantir la justice sociale et environnementale. D'autre part, la
somme des comportements individuels ne fera jamais une décision collective et
démocratique, tout comme la somme des intérêts individuels n'aboutit pas
naturellement à l'intérêt collectif.
La question du climat montre bien toute l'importance de
la bataille qui se joue. Si l'on veut à ce point nous apprendre à fermer le
robinet quand nous nous brossons les dents, c'est pour mieux nous détourner des
véritables causes de la crise écologique et sociale : le néo-libéralisme et sa
pierre angulaire, le libre-échange. L'éco-citoyenneté qu'on cherche à nous
inculquer ressemble fort, au contraire, à un abandon progressifs de la
citoyenneté. Renvoyés à nos comportements domestiques (moins prendre la voiture,
éteindre la lumière, trier ses déchets...) et à nos choix de consommateurs
(acheter bio, recyclé ou recyclable...), nous sommes soigneusement écartés des
véritables décisions politiques. Finalement, la crise environnementale pose une
question qui surplombe toutes les autres : alors que la mondialisation s'est
attachée à la détruire, sommes-nous capables de reconquérir notre souveraineté
populaire pour redevenir, sans préfixe, des citoyens à part entière
?



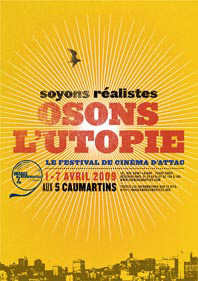




Commentaires
1. soazinette le 01-03-2009 à 11:34:33 (site)
Dommage que cela soit si loin.
Mon vélo est fatigué mais j'irais peut être un jour me perdre dans vos girons. En tout cas, vous m'en donnez l'envie.
Bon dimanche (sous mes applaudissements).
La bigoudène,
SoAz